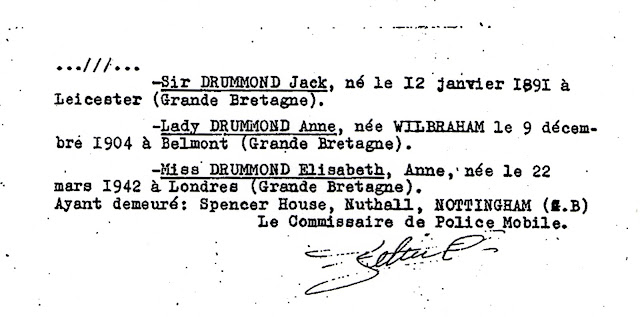.
Ce jeudi 5 septembre 2013, rentrée de l'émission "Des paroles et des actes" avec la Garde des Sceaux.
Présentation par FR2 :
- "Christiane Taubira, ministre de la Justice, est l'invitée de David Pujadas. Elle vient exposer et discuter les grandes lignes de la réforme pénale qu'elle souhaite mettre en place. Face à elle, les journalistes de la rédaction de France 2 reviennent [sur ?] le parcours au Gouvernement de la ministre."
Pour un étranger comme moi, un bref rappel n'est point superflu. Cette réforme pénale française pourrait se résumer en quelques grands axes :
- individualisation de la peine, en supprimant les peines plancher mises en place sous Nicolas Sarkozy ;
- instauration d’une libération sous contrôle pour éviter les « sorties sèches » (sans préparation : aides à la famille, recherches d’un logement, d’un emploi, sans accompagnement, sans suivi, sans contrôle…) ;
- mise en place d’une « contrainte pénale », soit une peine sans incarcération, mais une peine élaborée pour éviter que de « petits délinquants » ne décrochent encore plus derrière les barreaux de prisons surpeuplées et criminogènes.
On pouvait craindre une émission certes politique mais trop technique. En réalité, les dérapages furent tout autres.
Le Figaro :
- "Un show. La garde des Sceaux est pour la première fois l'invitée, jeudi soir, de l'émission politique de France 2 Des paroles et des actes. Une apparition médiatique inhabituelle pour l'icône du mariage pour tous."
(5 septembre 2013).
En deux courtes phrases, trois mots : "show", "apparition" et "icône" traduisaient l'état d'esprit avant l'émission ! Pour des journalistes présentant celle-ci, pas question de politique au sens noble du terme mais de "show", un spectacle dévalorisant encore mieux le sujet s'il pouvait sombrer dans le "realityshow". FR2 deviendrait Lourdes avec l'annonce spectaculaire de "l'apparition" de Mme Taubira. Celle-ci se trouvait réduite à l'état d'"icône", une image (sacrée) peinte sur du bois (avec un langage en adéquation). Et pour quel motif ? "Le mariage pour tous". Parce que la ministre de la Justice laissera, que cela plaise ou non, son nom dans l'histoire ! Pour avoir, en France terre des libertés (en retard dans ce cas précis), fait voter démocratiquement l'égalité entre les hétérosexuels et les homosexuels souhaitant le mariage...
Venons-en à l'émission. Dès les premiers mots, il se confirma que cette édition "Des paroles et des actes" manquerait de rigueur, de distance, de profondeur.
David Pujadas :
- "Elle [Mme Taubira] est devenue une figure passionnelle de la vie politique. Quand on l'aime, c'est souvent de l'idôlatrie. Quand on ne l'aime pas, c'est parfois de la détestation."
(Introduction à l'émission).
Voilà ! Pujadas prévient charitablement. Nous ne serons pas dans le registre des réflexions, des analyses, des échanges, des idées voire des idéaux. Pas de droit, ni de politique, ni de sociologie, ni de philosophie, ni même de poésie. Place au "passionnel" avec son plus pur manichéisme : "aimer" ou "détester" l'invitée, une "idôle" (cette fausse divinité).
Ce parti pris durera jusqu'en fin d'émission.
Franz-Olivier Giesbert à Mme Taubira :
- "Vous êtes une bête de télé mais il y a quelque chose de nouveau chez vous, c’est un peu de langue de bois..."
(Conclusion personnelle).
Pour Giesbert qui ne manque pas de vocabulaire, un seul mot résume cette femme originaire des anciennes "colonies", une personnalité pour le moins originale, une élue du peuple, à la tête d'un ministère clef. Madame Taubira est "une bête" !!! L'émission sert de décors à des jeux du cirque avec gladiateurs et animaux. Pujadas préside l'ouverture du show et Giesbert lève ou baisse le pouce en empereur des média.
Tout ce qui précède relève des dérives, des populismes dans lesquels se distinguent des journalistes-vampires, lesquels cherchent la célébrité à travers celle de leurs invités. L'obsession des audiences audiovisuelles, la facilité des coups médiatiques passent avant toute déontologie. Un service public est parasité pour mieux attirer vers le bas ce public...
Rien de bien nouveau sinon que l'émission "Des paroles et des actes" a franchi un pas supplémentaire : enfermer la Ministre dans une impasse. Pour ce faire, les responsables n'ont pas évoqué son projet de réforme. Ils instrumentalisèrent un seul cas particulier ne relevant aucunement de ce projet. Par le biais anonyme de la mère d'une victime. Avec une telle charge émotionnelle que l'atmosphère en devint irrespirable. En sachant que face à ce cas exceptionnel, la Ministre ne pourrait répondre. Faute de remettre en cause une chose jugée, d'évoquer un dossier judiciaire en public et qui plus est, en méconnaissance de ce dossier, bref faute de métamorphoser un plateau de tv en tribunal populiste. Comme pour se justifier, David Pujadas affirma faire oeuvre de "pédagogie" ? Il avait trouvé la rime avec démagogie.
Mme Taubira (Capt. d'écran).
Cette émission est promise aux écoles de journalisme. Et pas seulement. Elle soulève de vraies questions sur le fond et sur la forme.
Je suis navré du peu d'échos et d'interrogations qui s'en suivirent dans la presse française au premier rang de laquelle Le Monde et Libération brillèrent par leur silence de plomb (quand ces lignes sont écrites).
Voici néanmoins quelques extraits de presse :
Flore Thomasset : "la justice ne se prononce pas sur les plateaux de tv"
- "L’intervention de la mère de la victime de Colombes, violemment agressée par un condamné en semi-liberté, jette un froid sur le plateau. La ministre refuse de réagir : « Face aux victimes, je fais silence. La justice ne se prononce pas sur les plateaux de télévision. »
Rappelée à plusieurs reprises aux critiques de laxisme formulées à son encontre par la droite mais aussi une partie de la gauche, Christiane Taubira défend « le suivi intense et personnalisé » qu’instituera la contrainte pénale et rappelle la construction à venir de 6 500 nouvelles places de prison : « La prison est une institution républicaine qui assure une mission régalienne. Les juges apprécieront la peine la plus adaptée, la plus efficace. »
(La Croix, 6 septembre 2013).
Rémi Noyon : "Pujadas demande de comptes"
- "Pujadas demande du « concret ». Justement, la mère d’une jeune femme victime d’un multirécidiviste prend la parole. En ombre chinoise, pour préserver son anonymat, elle décrit le parcours du bourreau qui a défiguré sa fille. En semi-liberté, il est passé à travers les mailles du contrôle pour « poursuivre ses petits trafics ».
Elle parvient à articuler :
« Pour des barbares comme celui-là, nos lois ne correspondent pas. »
En faisant des pauses entre chaque mot pour bien marquer la lourdeur du témoignage, Pujadas demande des comptes à Christiane Taubira. Pas folle, celle-ci préfère esquiver :
« J’ai une règle : face aux victimes, je fais silence. »
(Rue89, « DPDA » : « Rendez-nous Taubira, la teigne pleine de fantaisie »,6 septembre 2013).
Adrien Francius : "la dictature de l'émotion"
- "Du dernier numéro de l'émission présentée par David Pujadas, « Des paroles et des actes », diffusée hier sur France 2, on ne retiendra que les nombreuses embûches semées sur le chemin de l'invité de la soirée, la Garde des Sceaux, Christiane Taubira. Et la charge fut violente, inhabituelle, notamment lorsque le témoignage - anonyme - d'une mère de victime, qui apparaît le visage masqué, en ombre chinoise, est passé à l'antenne. « Ce personnage (l’agresseur de sa fille) est irrécupérable » ; « Il viole tout en jurant sur le Coran, puis il rentre à la prison (il jouissait d’une permission de sortie) avec du sang sur ses vêtements, sur ses chaussures... C'est un barbare ! » fustige la mère.
Que répondre ? « Face aux victimes, je fais silence ! » déclare la ministre, qui répète sobrement, à plusieurs reprises, qu'elle « s'incline », tout en refusant de commenter sur le plateau d'une télévision une décision de justice. Le respect étant ainsi donné en réponse à la dictature de l'émotion qui semble avoir gagné France 2. Faute déontologique que de vouloir instrumentaliser la douleur pour faire de l'audience, faute d'appréciation de la direction, qui s'ajoutent aux nombreuses questions-pièges cette fois plus classiques. « On me rend comptable de tout, et je l'accepte » confie Christiane Taubira, soumise à un long interrogatoire."
(Marianne, Christiane Taubira tient bon, 6 septembre 2013).
Julien Amhrein : Taubira - Sarkozy
- "La rigueur que s'impose Christiane Taubira l'a empêchée de répondre au témoignage émouvant de la mère de Priscilla. Les paroles de consolation prononcées étaient dignes et sans doute sincères, mais certains jugeront que ce n'est pas assez par rapport à un ancien chef de l'État qui aurait pris cette pauvre dame en empathie, vitupérant contre ces juges irresponsables et annonçant un durcissement des sanctions. Démago mais sans doute plus populaire..."
(Le nouvel Observateur, Le Plus, "Des Paroles et des actes" sur France 2 : la prestation de Taubira, un vrai moment de télé, 6 septembre 2013).
La Garde des Sceaux - la mère d'une victime, témoin anonyme (Capt. d'écran).
Bruno Beschizza, ancien policier, Monsieur Sécurité de l'UMP
- "Une victime mais cela n’intéresse pas Mme Taubira, elle ne soucie que des voyous !"
(Réaction sur Twitter pendant l'émission)
Thierry de Cabarrus : "une question de dignité"
- "Abordant enfin la réforme de la procédure pénale, David Pujadas a opposé à la ministre un argument... de chair et de sang, un témoin bouleversé de chagrin et de haine : la mère d'une jeune fille violée et tabassée par un délinquant sous contrôle judiciaire dans une affaire de conduite en état d'ivresse.
On se serait cru revenu sous l'ancien quinquennat, quand le président Sarkozy, endossant à chaque fait divers sordide, sa tenue d'ancien ministre de l'Intérieur, saisissait l'occasion pour faire une loi nouvelle, souvent contradictoire avec la précédente et totalement démagogique.
Sauf que Christiane Taubira n'est pas Nicolas Sarkozy et que David Pujadas en a été pour ses frais : la garde des Sceaux a eu raison de refuser, même et surtout peut-être en présence de ce témoin bouleversé qui attendait d'elle une impossible réponse à sa peine, de juger le juge d'application des peines que le journaliste lui présentait grossièrement pour qu'elle dénonce ses éventuelles fautes et qu'elle lui coupe la tête.
Sauf que Christiane Taubira n'est pas tombé dans le piège de la facilité qui consistait à multiplier les preuves de son indignation à l'égard d'une justice qui peut aussi se tromper et les signes de sa compassion impuissante envers cette femme brisée impossible à consoler.
Il me semble que c'était une question de dignité, à la fois pour les familles des victimes et pour ceux qui rendent la justice, que de ne pas vouloir plaider ou requérir ainsi sur le vif, à la télévision, dans un dossier dont elle ne connaissait aucun élément sérieux."
(Le nouvel Observateur, Le Plus, "DPDA" : comment Christiane Taubira a évité les pièges de David Pujadas sur France 2, 6 septembre 2013).
Daniel Schneidermann : "passe ici le fantôme du sarkozysme médiatique"
- "La ministre face à la victime : Pujadas tient sa séquence, celle qui scotche, celle qui restera. Sur le visage impassible en gros plan, le moindre tremblement est un signe, un aveu, un discours : compassion, empathie, indifférence, insensibilité ? Rien ne va plus : roule roule la roulette de la condamnation ou de l’acquittement de la ministre. Quels mots va-t-elle trouver ? Les connaît-elle déjà, ou va-t-elle improviser ?
Elle choisit le silence. Non, elle ne donnera pas à Pujadas ce qu’il attend, ce qu’attend tout le dispositif. Elle n’aura pas un mot de commentaire sur le cas particulier de Priscilla.
Bravo ! Passe ici le fantôme sinistre du sarkozysme médiatique, des lois-faits-divers sorties du chapeau sous le coup de l’émotion. On l’approuve d’autant plus que le cas évoqué n’a aucun lien avec la fameuse « contrainte judiciaire », qui n’est pas censée s’appliquer aux récidivistes. Elle ne tombera pas dans le piège. « Mais tout de même, il était en semi-liberté pour travailler dans une supérette, et cette supérette était fermée en août » insiste Pujadas. Non. Pas un mot."
(Arrêt sur image, 6 septempre 2013).
Bruno-Roger Petit : "cette séquence... est une faute grave"
- "De ce "Paroles et des actes", l'histoire de la télévision retiendra un passage, un seul. Ce moment où David Pujadas a sorti de sa pochette-surprise le témoignage de la mère d'une victime. Un témoignage anonyme, émanant d'une ombre, exprimant tout à la fois douleur et haine, rage et désespoir.
Le moment fut pénible.
(…)
Il ne fait aucun doute qu'en organisant cette séquence, ce qu'il faut bien appeler un piège tendu à Christiane Taubira, les organisateurs ont jugé que l'aspect émotionnel fort, inévitable et inéluctable, allait accoucher d'un moment de télévision d'une intensité incomparable.
Plus terrible encore, peut être, il est même vraisemblable qu'ils aient cru faire œuvre d'humanité en offrant cette tribune à une personne en grande souffrance et immense colère.
(…)
Oui, Christiane Taubira ne pouvait que se montrer impuissante face à ce cas extrême, dont la charge émotionnelle balayait toute volonté de rationalité. C'est là, et nulle part ailleurs, que réside le piège dans son caractère le plus odieux : Christiane Taubira ne pouvait pas s'en sortir. Elle ne pouvait offrir que son écoute attentive et son silence respectueux. Ce qu'elle a fait...
Cette séquence est plus qu'une erreur, c'est une faute grave.
De quoi parlait-on dans ce "DPDA" ? De la Justice, de ce qu'elle incarne, de ce qu'elle vise. De droit pénal, de sanction, d'échelle des peines... En politique, c'est la matière qui ne souffre ni passion, ni émotion, celle où s'impose la raison et la réflexion. C'est ce que l'on apprend en 1ère année de droit, quand on débute dans le droit pénal : que la justice est rendue au nom de la société, à raison du tort que le crime ou le délit lui ont causé, et que c'est pour cette raison qu'elle relève de la puissance publique, qui doit agir alors de la manière la plus rationnelle et la plus apaisée qui soit.
Jusqu'à ce "DPDA" d'anthologie, de mémoire de téléspectateur, jamais un ministre de la Justice n'avait été ainsi piégé par un témoignage anonyme, destiné à le mettre en difficulté, par le jeu de l'émotion et de la passion. Jamais.
(…)
Quelle idée se font-ils de nous, les responsables de l'information de France 2, pour croire que nous ne sommes que des bêtes de télévision, ne réagissant que par stimuli émotionnels destinés à alimenter nos pires pulsions dès qu'il s'agit de Justice ? Pensent-ils que la ménagère de moins de cinquante ans est une descendante des tricoteuses de la Terreur ?
Voilà pourquoi, tout téléspectateur, soucieux d'assister à un débat serein et équilibré sur les problèmes de justice, ne pouvait que se sentir honteux et piteux devant sa télévision, se voyant aussi mal considéré par ceux qui ont pour vocation de l'informer, donc de l'éclairer.
(…)
Ainsi va la télévision en 2013... Un petit monde qui ne donne plus à réfléchir mais à rugir... Un petit monde qui n'offre plus à penser mais à hérisser...
(Le nouvel Observateur, Le Plus, "DPDA" : Taubira piégée par un témoignage anonyme, l'indignité de Pujadas et France 2, 6 septembre 2013).
La séquence litigieuse débute à 57 minutes 45 secondes.
.